- Émilie Querbalec
blog
Recouvrer la Terre
Dans son livre « Au cœur des trous noirs », Aurélien Barrau met en scène un dialogue entre deux personnages, Hécate et Héliogabale. Évoquant l’énergie et la lumière dispensées par le Soleil, Hécate exprime le souhait que nous puissions utiliser ce processus de fusion nucléaire pour « disposer d’une source d’énergie propre et abondante sur Terre ». A cela, Héliogabale répond : « Tu plaisantes, n’est-ce pas ? Ce qui tue la vie sur Terre, ce ne sont ni les émissions de gaz à effet de serre, ni un éventuel manque d’énergie disponible (…). Tant que nos valeurs et nos désirs ne changent pas radicalement, disposer d’une énergie presque infinie serait la pire nouvelle possible, même si elle s’avérait propre ».
À quoi ressemblerait un monde où la fusion nucléaire serait devenue une réalité et où l’on aurait continué à développer notre économie en suivant la logique actuelle de croissance et de consommation ? Une telle civilisation, j’imagine, aurait aussi trouvé les moyens de limiter la pollution au plastique et à limiter toutes les nuisances et pollutions liées à l’activité humaine. Peut-être même aurions-nous commencé à exploiter des mines sur des astéroïdes ou sur des planètes voisines dans le système solaire, palliant ainsi l’épuisement de nos ressources en matières premières et allant chercher ailleurs les métaux rares dont nos villes et nos systèmes de plus en plus sophistiqués auraient besoin pour fonctionner. Nos cités ressembleraient à ce que les architectes visionnaires de The Line (https://www.neom.com/fr-fr/regions/theline) auraient imaginé, des tours vertigineuses ponctuées de rares touches de végétation. Notre monde hyper-urbanisé et connecté aurait peut-être un vague air de familiarité avec la planète Coruscant, dans Star Wars.

Nos océans seraient parcourus de câbles et notre ciel étoilé serait rayé des traînées des multiples satellites de télécommunication que des sociétés privées auraient déployé par dizaines de milliers autour de la Terre.
Mais dans ce monde futur, complètement artificialisé, y aurait-il encore des mésanges, des pies, des merles, des lombrics et des papillons, des ours, des loups, des éléphants et des girafes, des écureuils, des renards, des castors, des marmottes, des abeilles, des koalas, des dauphins, des cachalots, et puis aussi des hêtres, des ormes, des chênes et des cèdres, des séquoias, des pins, des saules et des bouleaux, et la liste est longue, très longue, de toute la faune et la flore, de tous les êtres qui peuplent notre planète, du plus petit au plus massif, à poil, à plume, à dendrite, à ventouse, à palmes et à sabot, à bec, à coussinet, à corne, à queue et carapace, toute cette vie foisonnante, inventive, surprenante mais qui chaque jour qui passe voit mourir par centaines et par milliers, parce que leur espace vital se réduit comme peau de chagrin en raison du développement incessant de nos activités.
Alors peut-être que dans ce monde où nous aurions trouvé le saint Graal de l’énergie propre et illimitée, conjointement à l’exploitation des ressources infinies puisées dans l’espace, nous aurions aussi retrouvé un peu de bon sens pour préserver autrement que dans des banques de données, ces versions dématérialisées de l’arche de Noé, la précieuse diversité de la vie sur Terre. Au passage, nous aurions appris à prendre soin des sols qui nous nourrissent, nous évitant de multiples catastrophes humanitaires dont même nos sociétés riches n’auraient probablement pas su se protéger malgré les murs et les frontières.
Mais en attendant qu’advienne ce paradis technologique, peut-être serait-il quand même prudent d’envisager des alternatives à cette trajectoire.
Dans ma sensibilisation au sujet de la relation que nous entretenons au vivant, il y a quelques lectures et quelques œuvres qui m’ont durablement marquée et continuent de m’inspirer.
L’une d’elles est Nausicaa de la vallée du vent, de Hayao Miyazaki. Dans le monde de Nausicaa, l’humanité est réduite à des communautés isolées sur une Terre hostile, grignotée par la fukai, une forêt qui abrite une faune et une flore toxiques pour les humains. En lutte permanente contre cette forêt, les différentes factions ne parviennent pas à trouver la paix. Nausicaa est celle qui va réussir à réconcilier le monde sauvage, représenté par les Ômu, ces insectes gigantesques gardiens de la forêt, et celui des hommes. Le twist final révèle l’origine artificielle de la forêt, conçue pour dépolluer la Terre par la puissante civilisation technologique qui a dominé jadis, avant sa chute.
Le monde sauvage est très présent également dans une autre œuvre phare de Miyazaki, Princesse Mononoke. Dans ce dernier, une lutte sans merci oppose les habitants de la forêt des humains venus s’installer là. Chacun obéit à sa logique propre qui exclut radicalement l’autre, car il en va de leur survie. A la fin, un compromis est trouvé, incarné par les deux protagonistes humains. Mononoke retourne vivre dans la forêt, Ashitaka regagne le village humain. L’esprit de la forêt a été décapité, mais la végétation se régénère et ce nouveau cycle qui commence est aussi la promesse d’un avenir où on aurait enfin trouvé un équilibre entre le monde des non-humains et le monde des humains.
Dans son livre Le Ministère du Futur, Kim Stanley Robinson imagine une politique volontariste d’attribution de la moitié de la planète à la faune sauvage afin de lui permettre de vivre dans des corridors biologiques à l’échelle des continents. Les humains ne seraient pas, ou très peu autorisés à pénétrer ces espaces protégés et sanctuarisés. Plus qu’une cohabitation, on serait dans une sorte de dualisme radical où les mondes humains et non-humains ne devraient pas se côtoyer ou s’interpénétrer. La nature d’un côté. Les humains de l’autre. Si un projet d’une telle envergure ne semble pas près d’advenir, ce principe de séparation est celui défendu par le projet Half Earth, qui lui est bien réel (https://eowilsonfoundation.org/)

Mais ne pourrait-on imaginer des alternatives à cette séparation radicale ? Après tout, de nombreux peuples autochtones ont su cohabiter et co-évoluer avec leur environnement sans chercher à le dominer et à l’exploiter comme l’ont fait les modernes.
Baptiste Morizot, qui signe la préface au livre Le Vivant et la Révolution, Réinventer la conservation de la nature par delà le capitalisme de Bram Bûscher et Robert Fletcher aux éditions Actes Sud, écrit : « ce ne sont pas les humains en général qui détruisent le vivant, comme totalité, comme espèce, comme condition, mais une série de bifurcations historiques et non nécessaires qui ont donné leur forme économique à nos sociétés modernes tardives. » Les auteurs analysent quatre type de positions sur la conservation de la nature dans l’anthropocène :
La conservation dominante, qui se base sur l’idée de forteresses vides d’humains pour préserver la « wilderness », à l’américaine.
La nouvelle conservation, qui valorise les services écosystémiques et les concepts de « capital naturel », « croissance verte », etc.
Le néoprotectionisme, qui rejette la croissance et le consumérisme, et sépare radicalement l’humain de la nature.
La conservation conviviale, inspirée d’Ivan Illitch, qui valorise le « vivre avec ».
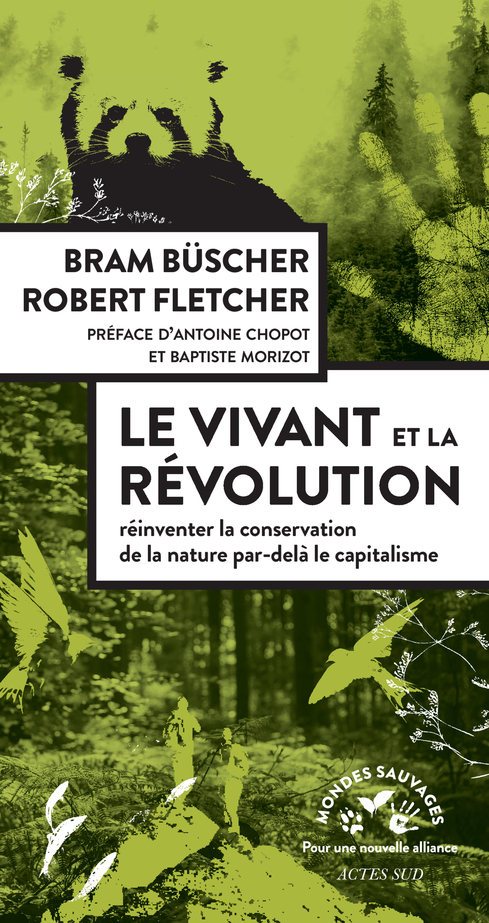
Dans un monde soumis à des pressions économiques, démographiques, politiques et climatiques de plus en plus complexes, sans doute faudrait-il combiner ces quatre approches pour réussir à sauver un tant soit peu la faune et la flore qui peuplent notre planète. Mais pour cela, il faudrait systématiquement prendre en compte les besoins de ces espèces non-humaines pour les intégrer dans tout projet empiétant sur leurs milieux de vie. En leur accordant de la valeur, et en cessant de les considérer comme quantité négligeable. Mieux : en prenant conscience de ces « tissages » entre espèces qui nous font vivre, pour reprendre une expression de Baptiste Morizot. Voilà qui serait radicalement nouveau dans notre approche moderne de la « nature ».
Ce sont toutes ces réflexions qui m’ont amenée à rapatrier mon imaginaire sur Terre pour écrire Les Sentiers de Recouvrance. Comme le dit le géographe et orientaliste Augustin Berque dans son essai « Recouvrance, retour à la Terre et cosmicité en Asie Orientale », « la Terre, c’est bien une planète, mais aussi c’est la terre que moi, je foule ici et maintenant. Si je suis, si j’existe, c’est parce qu’il y a la réalité de cette terre dont je suis moi-même un facteur constitutif, et c’est là mon authenticité. » Autrement dit, il n’y a pas la « nature » d’un côté, et l’humain avec ses systèmes symboliques et techniques de l’autre. Ce dualisme qui paraît inéluctable est en réalité une construction culturelle, comme le montre ce géographe formé à la philosophie orientale, mais aussi, par d’autres voies, l’anthropologue Philippe Descola.
La science-fiction s’inscrit souvent d’un côté de cette fracture, effectuant par le pouvoir magique de l’imagination ce bond qui permet de dépasser nos limites biophysiques pour investir des imaginaires qui survalorisent nos systèmes techno-symboliques. Dépasser les limites… ça ne vous rappelle rien ?
L’avenir n’est pas encore écrit, et de nombreux récits investissent l’angle mort du futur proche pour esquisser les contours de ce qui pourrait advenir, si nous le décidions collectivement. L’imaginaire peut nous aider à dépasser les peurs du présent.
Ces histoires existent, elles font l’objet de nombreuses expérimentations, par exemple ici : https://futursproches.com/
Bonne lecture.
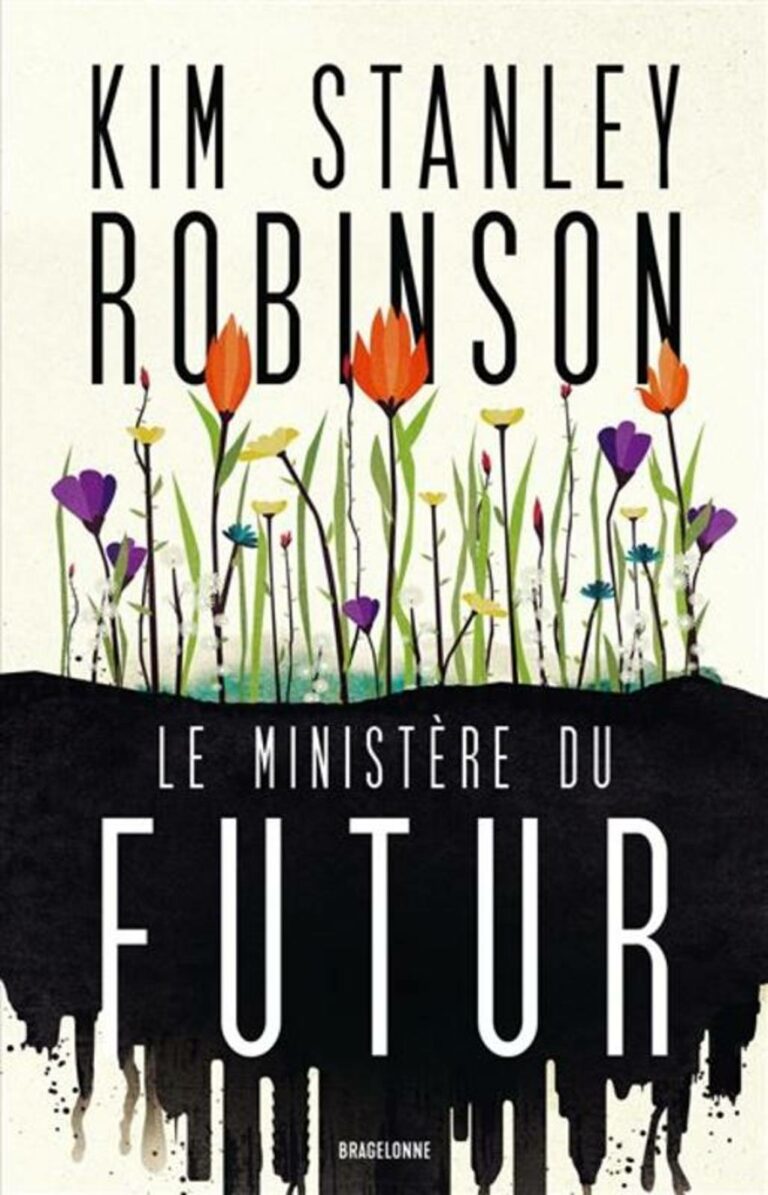
Partager l’article

