- Émilie Querbalec
blog
À propos de fiction panier
Cela fait quelque temps que je voulais écrire un billet sur la fiction panier, dont on m’avait demandé il y a quelques temps de faire une brève présentation dans le cadre d’un atelier de réflexion sur la communication d’entreprise.
Le concept de fiction panier m’intéressait, parce qu’il exprimait à mes yeux une contestation vis-à-vis d’une certaine forme de science-fiction, contestation qui faisait écho avec mes propres préoccupations.
L’expression fiction panier a été employée par l’écrivaine Ursula K Le Guin dans un article intitulé Le fourre-tout de la fiction, une hypothèse (The Carrier Bag Theory of Fiction, 1986).
Si vous ne connaissez pas Ursula K Le Guin, cet excellent épisode de la Méthode Scientifique vous donnera un aperçu de l’ampleur de son œuvre ainsi que quelques conseils de lecture parmi sa longue bibliographie : la SF aux couleurs d’Ursula K Le Guin
Il y a aussi ce documentaire très émouvant, réalisé par Arwen Curry, Worlds of Ursula K. Le Guin
Pour ma part, je suis entré dans son univers avec la lecture de Lavinia, puis ont suivi La Main gauche de la nuit, Le nom du monde est forêt, le Dit d’Aka, ou encore les Dépossédés. Un peu plus tard sont venus ses poèmes, tandis que parallèlement je découvrais ses articles regroupés dans le recueil Danser au bord du monde (traduction française aux éditions de l’Éclat).
Tel un kaléidoscope à travers lequel la lumière se diffracte en de multiples effets, ces textes de conférences et communications qui s’échelonnent entre 1976 et 1988 font ressortir les thèmes et motifs qui traversent l’œuvre d’UKLG de manière à la fois intuitive et explicite. On y trouve de nombreuses réflexions sur la narration, la prose et la poésie, le métier d’écrivain, mais aussi des sujets de société tels que l’identité de genre ou le féminisme, le tout entremêlé de réflexions sur la science-fiction.
Ainsi ce célèbre le fourre-tout de la fiction, une hypothèse.
Il est intéressant d’observer que cet article a été, et est toujours, une source d’inspiration pour des gens de sensibilités politiques diverses, et qui ne viennent pas nécessairement du monde de la science-fiction. Vous le trouverez mentionné, par exemple, sur des blogs de lutte et résistance d’inspiration écologique, féministe ou anarchiste comme terrestres.org ou bien encore partage-le.com
Je suppose que chacun lit et interprète ce texte à l’aune de son expérience et de sa formation intellectuelle. J’y ai trouvé pour ma part une résonance avec ma propre sensibilité au monde. Le plus amusant est que je ne connaissais pas la théorie de la fiction panier avant qu’un blogueur ne la mentionne concernant mon roman Les Chants de Nüying.
Aujourd’hui, je peux dire sans trop exagérer que la découverte de ce texte et la réflexion d’UKLG sur la science-fiction en général m’ont aidée à mûrir en tant qu’autrice. Ce que je cherchais de manière instinctive, nourrie de mes propres références, influences, expériences et culture, y a trouvé une forme de confirmation. Et quelle confirmation !
Toute fiction est politique, mais la science-fiction est certainement le genre littéraire le plus en prise avec l’évolution de nos sociétés sous le règne de la technologie. Et ce qu’en dit Ursula K Le Guin rejoint, il me semble, les voix multiples des anthropologues, géographes, philosophes, sociologues ou historiens ayant travaillé sur la manière dont la modernité née en Occident a transformé le monde et les sociétés humaines à l’échelle planétaire. À présent que nous sommes entrés de plain-pied et de manière irréversible dans l’« ère de la combustion », pour reprendre l’expression de l’historien Achille Mbembe, il me semble difficile d’écrire de la science-fiction sans interroger les conséquences et les limites de cette modernité industrielle et technologique.
Quelle place accorder, aujourd’hui, à la notion de « progrès technologique », ce moteur intimement lié à l’essor de la science-fiction depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à la deuxième moitié du XXième siècle ?
UKLG propose un début de réponse dans Le fourre-tout de la fiction, une hypothèse : « Si la science-fiction est la mythologie de la technologie moderne, alors ce mythe est tragique », écrit -elle. La tragédie en question, c’est celle d’une civilisation confrontée à la perspective de sa propre fin alors même qu’elle ne cesse d’accroître son emprise sur le monde par le biais de technologies toujours plus puissantes et sophistiquées. Cette trajectoire prométhéenne, UKLG la compare à une flèche. La flèche file droit vers le futur, emportant avec elle une humanité prise dans sa dynamique conquérante. La flèche tue, mais au-delà de sa fonction, elle captive. Car « ce qui fit toute la différence, ce ne fut pas la viande, mais le récit ». Ce même récit qu’elle va s’appliquer à déconstruire en reprenant l’hypothèse de la féministe Elisabeth Fisher, qui postule que le premier artefact de l’humanité ne fut pas une arme, mais un contenant destiné à conserver le produit de la cueillette. Et UKLG de poursuivre avec humour :
« Mais (…) dans ce cas, qu’advient-il du merveilleux objet si gros, si long et dur (un os, je pense) que l’Homme Singe abat sur le crâne d’un autre dans ce film célèbre, avant de pousser un grognement d’extase à l’idée d’avoir perpétré le tout premier meurtre digne de ce nom, puis de le lancer vers le ciel où, tourbillonnant, il devient un vaisseau spatial se forçant un chemin dans le cosmos à féconder, pour donner, à la fin du film, un ravissant fœtus – mâle évidemment – qui dérive dans la voie lactée, sans (bizarrement) utérus ni matrice ? »
Vous aurez reconnu 2001 Odyssée de l’espace, adaptation cinématographique de l’œuvre de Arthur C. Clarke par Stanley Kubrick. Cette œuvre majeure de la science-fiction ne raconte rien de moins que l’évolution de l’Homme au fil de son histoire. Homme avec un grand H, bien sûr, car les femmes n’étaient pas considérées comme pouvant participer de ce grand récit civilisationnel, porté par la figure d’un Héros aventurier, scientifique, explorateur, ingénieur ou bien encore guerrier. Blanc et occidental, faut-il le préciser ?
Ce récit-là, Ursula K Le Guin le qualifie de « récit qui tue ». Un récit dans lequel elle a bien du mal à se reconnaître, et dont elle souhaite se démarquer :
« Ce n’est pas cette histoire-là que je raconte. Celle-là, on la connaît, tous nous savons tout ce qu’il y a à savoir sur tous les gourdins, javelots et cimeterre, tout ce qui assomme, transperce et frappe, toutes ces choses longues et dures; en revanche, nous ne savons rien des choses qui servent à en contenir d’autres, le contenant de la chose contenue. Ça, c’est une histoire nouvelle. C’est de l’inédit. »
Mais qui pourrait bien s’intéresser à ces « histoires nouvelles » écrites par une femme ? Fin des années cinquante, début des années soixante, la science-fiction est encore largement dominée par un imaginaire masculin, lequel se décline en nombreux récits d’aventures et conquêtes à base d’avancées technologiques plus ou moins mirobolantes.
De fait, Ursula K Le Guin reçut un certain nombre de refus de la part des éditeurs de science-fiction au début de sa carrière, comme le rappelle le documentaire The Worlds of Ursula K Le Guin. Arrivent les années soixante, la guerre du Vietnam, les mouvements protestataires, les luttes pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, contre le racisme…. Heureusement, la société et les mentalités évoluent, la science-fiction également.
En 1969, La Main gauche de la nuit reçoit le prix Nebula du meilleur roman, suivi du prix Hugo en1970. Loin des récits de conquête, d’aventures dans des mondes exotiques ou de batailles spatiales épiques, La Main gauche de la nuit offre un récit de voyage au rythme lent, où l’on plonge peu à peu dans la complexité d’une civilisation sur une planète imaginaire où de très anciennes expérimentations génétiques ont donné naissance à une espèce humaine dont la physiologie a la particularité d’être hermaphrodite – les organes génitaux seront mâles ou femelles, selon les circonstances et la relation que l’on a avec les partenaires présents au moment du cycle où l’on est sexuellement actif.
Un autre aspect de cette fiction-panier qui me semble important est la destitution du Héros en tant que personnage central et moteur de l’histoire. La figure du Héros est intimement liée à la symbolique de la flèche et à la forme des récits qui en découlent. Et ceci explique aussi la fascination exercée par ces histoires :
« C’est puissant, un Héros. En un clin d’œil, les hommes et les femmes du champ d’avoine ainsi que leurs enfants, l’art de l’artisan, les pensées des penseurs et les chants des chanteurs se trouvent embringués, entraînés de force dans le récit du Héros et mis à son service. »
Ce Héros et sa déclinaison moderne en science-fiction, UKLG n’a de cesse de pousser à bas de son piédestal. Dans son article La vieille dame et l’espace, par exemple, elle se demande qui nous devrions choisir pour représenter l’espèce humaine si un seul être humain devait dialoguer avec des extra-terrestres venus d’Altaïr :
« La plupart des gens recommanderaient un jeune homme courageux et méritant, brillant, instruit, et en excellente forme physique. Un cosmonaute soviétique, par exemple (…). Il y aurait sans doute des centaines, voire des milliers de candidats sur le modèle de ce jeune homme (…). Mais moi, je ne ferais pas mon choix parmi eux. Je ne retiendrai pas non plus les jeunes femmes (…). Non, moi j’irai au grand magasin du coin ou au marché du village, et je choisirais une vieille dame, en tous cas plus de soixante ans (…) Elle a travaillé dur toute sa vie pour assurer toutes sortes de tâches subalternes – faire la cuisine et le ménage, élever des enfants, vendre des bibelots qui décorent ou font plaisir. Elle a été vierge, il y a longtemps, puis sexuellement puissante et fertile ; après quoi elle a passé la ménopause. Elle a donné la vie et affronté la mort plusieurs fois ( ….). Peut-être sauront-ils (les altaïriens) discerner le noyau de cœur et d’esprit qu’intuitivement, et grâce à l’espoir, nous appelons une humanité bienveillante. (…). Si elle a été choisie, c’est justement parce que seul peut représenter fidèlement l’humanité un être ayant ressenti, accepté et mis en actes la totalité de l’expérience humaine, dont la principale caractéristique est le changement. »
Exit le Héros, donc, et vivent les récits mettant en lumière cette autre humanité, la majorité, à vrai dire, celle dont une certaine forme de science-fiction, héritière de la tradition du récit épique ou d’aventure, s’est bien peu préoccupée.
Pour résumer, dans la fiction-panier appliquée à ce genre qu’est la science-fiction, on trouvera donc des histoires :
– Qui évacuent le modèle du héros masculin, dominant, conquérant,
– Dont le moteur narratif principal n’est pas le conflit armé
– Qui s’écartent d’une vision techno-héroïque et mégalomaniaque du progrès scientifique et technologique,
– Qui questionnent la place et la finalité de la technologie dans l’évolution des sociétés
– Qui mettent en lumière une humanité plus ordinaire, moins spectaculaire, ces fameux cueilleurs d’avoine
– Et qui donc, s’intéressent et valorisent toute la richesse et la diversité de l’expérience humaine
La science-fiction devient ainsi :
« (..) un champ beaucoup moins rigide et étroit, pas du tout condamné à être prométhéen, apocalyptique, et, de fait, (…) un domaine littéraire relevant moins de la mythologie que du réalisme. »
Cette comparaison avec la littérature réaliste me semble importante. En effet, c’est justement parce que la littérature de science-fiction reprenait, en la modernisant, la forme traditionnelle de l’odyssée ou du récit d’aventure et de conquête qu’elle était devenue ce qu’UKLG appelle l’histoire qui-tue. Cette remise en question avait déjà opéré dans le domaine du roman réaliste. UKLG va même jusqu’à dire que :
« (…) la forme naturelle, adéquate, correcte, du roman, pourrait être celle de la besace, du sac. Un livre renferme des mondes. Les mondes renferment des choses. Ils revêtent des significations. Un roman (…) contient les choses dans la relation particulière et puissante qu’elles entretiennent les unes avec les autres, et avec nous. »
Et elle ajoute :
« C’est pour cela que j’aime les romans : en lieu et place de héros, ils contiennent des gens. »
Quand je lis cette phrase, je pense aussitôt au personnage de Shevek, le physicien qui est au cœur de l’intrigue de Les Dépossédés, pour moi l’un des personnages les plus complexes, les plus profondément humains et bouleversants de la littérature contemporaine, tous genres confondus.
Concernant la volonté d’UKLG de déplacer le champ littéraire de la science-fiction du récit d’aventures héroïque vers celui du roman réaliste, on pourrait mentionner l’influence exercée par Virginia Wolf sur son approche. Virginia Woolf qui voulait :
« raconter une histoire différente en ayant recours à une structure nouvelle ».
UKLG propose d’ailleurs, non sans malice, de se joindre à sa consœur pour transformer le héros en bouteille… à moins de faire de la bouteille le Héros !
C’est peut-être tout cela qui fait le charme et la force de cette science-fiction défendue par UKLG. Loin d’appauvrir ou diminuer le genre, elle lui donne ses lettres de noblesse, avec toute l’autorité et la reconnaissance qui lui ont été accordées par le monde des lettres (voir à ce sujet le documentaire Worlds of Ursula K Le Guin et le discours qu’elle a prononcé en 2014 à l’occasion de la remise de la médaille du National Book Foundation).
J’espère que ce billet vous aura éclairé sur la symbolique en jeu dans cette fiction-panier. En une image, Ursula K Le Guin condense une réflexion critique sur l’évolution de nos sociétés et les formes narratives qui alimentent sa dynamique, tout en offrant des pistes pour s’en extraire et ouvrir grandes les portes à des récits alternatifs, nouveaux, transformateurs. Pour conclure, je ne saurais trop vous conseiller de lire le texte original de ce fourre-tout de la fiction, et de vous en faire votre propre idée. Car…
« Il reste des graines à ramasser, et de la place dans le fourre-tout des étoiles ».
Ursula K Le Guin, Le Fourre-tout de la fiction, une hypothèse.
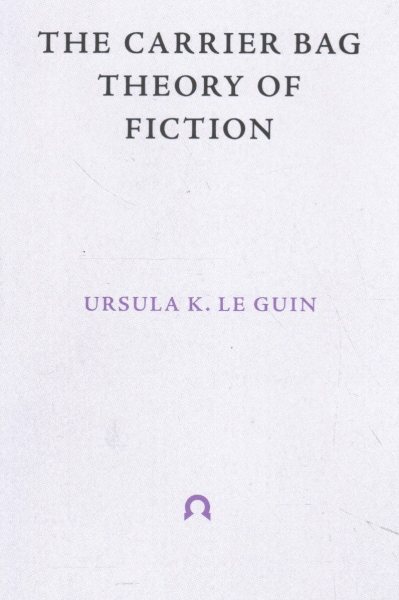
Partager l’article
